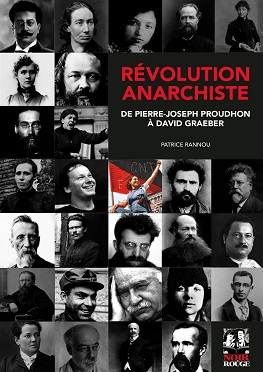
Dans la revue Pagine Libertarie (20 novembre 1922), Camillo Berneri écrivait : « Nous sommes dépourvus de conscience politique en ce sens que nous ignorons les problèmes actuels et que nous continuons de diluer les solutions acquises dans notre littérature de propagande […]. L’anarchisme doit préserver cet ensemble de principes génériques qui constituent le fondement de sa pensée et le moteur passionné de son action, mais il doit savoir affronter le mécanisme complexe de la société actuelle sans lunettes doctrinales et sans attachement excessif à l’intégrité de sa foi. »
La réflexion de Berneri est stimulante et enrichissante pour celles et ceux qui souhaitent conjuguer une vision à une série de projets. La vision est le rêve et le cadre de référence ; les projets sont les solutions concrètes et nécessairement expérimentales que l’on peut proposer face aux nombreux problèmes et enjeux critiques de la coexistence. Dès lors, la pensée et l’action sont intrinsèquement liées et s’opposent. Partant de ce postulat, il apparaît de plus en plus évident que l’anarchisme (ou plutôt les anarchismes) doit systématiquement s’interroger sur sa capacité à s’inscrire dans le cours de l’histoire, ne serait-ce que pour contrer un processus de domination, mais qu’il ne peut plus, sous peine de devenir insignifiant, se tenir à l’écart de l’histoire.
Ce défi apparaît de plus en plus central et exige d’être relevé, en dépassant une pratique de luttes centrée uniquement sur la résistance et la dénonciation des diverses formes que prend systématiquement la domination, et en orientant ainsi l’action vers des luttes et des expériences fondées sur des propositions concrètes et proactives. En 1961, un article de Colin Ward, intitulé « Anarchisme et respectabilité », parut dans l’hebdomadaire anarchiste anglais Freedom. Ward y écrivait : « Le sujet que j’aborde dans ce symposium est le suivant : “Sommes-nous suffisamment respectables ?” Et par cette question, je n’entends pas interroger sur nos vêtements, la conformité de notre vie privée aux normes statistiques, ni sur notre façon de gagner notre vie, mais sur la qualité de nos idées anarchistes, sur leur valeur et leur respectabilité. »
Vérifier cette respectabilité implique de se demander systématiquement si les idées de cette grande utopie sont meilleures et plus utiles pour résoudre les problèmes auxquels les hommes et les femmes sont confrontés quotidiennement. Autrement dit, si l’anarchisme est supérieur aux autres idéologies autoritaires lorsqu’il s’agit de créer une société plus libre, plus juste, plus respectueuse et plus compatissante. Mais nous devons agir immédiatement, sans attendre une révolution improbable, et de toute façon pas toujours souhaitable, qui nous conduirait vers un monde meilleur que celui dans lequel nous vivons. En conservant un esprit révolutionnaire, nous pouvons entreprendre ici et maintenant le changement individuel et social dans la direction libertaire vers laquelle nous aspirons idéalement.
En d’autres termes, la question posée ici peut se traduire et se développer ainsi : existe-t-il une conviction que, plutôt qu’un anarchisme « apocalyptique » visant le « tout ou rien », il existe des raisons de développer un anarchisme pragmatique, destiné à donner vie à de nouvelles communautés, ici et maintenant, à partir des réalités difficiles et contradictoires de notre quotidien ? La pensée anarchiste et l’anarchisme en tant que mouvement (les anarchismes) se caractérisent par leur fondement : la négation. Leur force révolutionnaire s’est historiquement exprimée dans la pensée des classiques, avant tout dans la dimension du rejet (de toute forme de domination). Mais l’ aspect destructeur de l’idée anarchiste n’est plus, à mon avis, capable à lui seul de saisir les grandes opportunités et les défis que l’époque contemporaine pose aux idéologies des XIXe et XXe siècles. De plus, il est réducteur, voire parfois instrumental, de percevoir l’originalité et la force de l’anarchisme dans cette seule dimension de la négation.
Le rejet de toute forme de domination demeure un élément essentiel de la définition de l’idée anarchiste, mais je tiens à le considérer comme pleinement établi et, surtout, à souligner sa pertinence en tant que vision positive et préfigurative d’une société différente. Enfin, je réaffirme qu’aujourd’hui plus que jamais, il est urgent de penser un anarchisme post-négatif et de mobiliser toutes nos ressources pour développer des axes d’action libertaires qui inversent la tendance intrinsèquement autoritaire présente dans la société et, simultanément, évitent les constructions idéologiques et abstraites d’une société « complètement différente ». Dans l’immédiat après-guerre, Herbert Read et Alex Comfort, Geoffrey Ostergaard, George Molnar, Paul Goodman, Martin Buber, George Woodcock, Murray Bookchin, Colin Ward, Gaston Leval, ainsi que des revues comme Politics de Dwight Macdonald , Anarchy de Ward et Volontà de Giovanna Berneri et Cesare Zaccaria , parmi d’autres contributions, ont tenté de tracer une voie différente de la voie traditionnelle, visant à moderniser non seulement la pensée anarchiste, mais surtout ses actions. On pourrait résumer ainsi les caractéristiques fondamentales de ce courant libertaire de ces dernières années :
a) Scepticisme à l’égard de la conception insurrectionnelle : critique de sa viabilité et conviction qu’un changement authentique et profond doit provenir d’un changement dans la personnalité individuelle et dans les relations sociales ;
b) « La liberté doit être conquise centimètre par centimètre et il est nécessaire d’enlever les chaînes que nous nous sommes imposées avant de pouvoir agir en êtres humains responsables » (Ostergaard) ;
c) « L’État n’est pas quelque chose qui peut être détruit par une révolution, c’est une condition, une relation entre êtres humains, une forme de comportement humain ; nous le détruisons en entrant dans de nouvelles relations, en nous comportant différemment » (Landauer) ;
d) « Une société libre ne peut être réalisée en remplaçant l’ancien ordre par un nouvel ordre, mais en élargissant les espaces de libre action jusqu’à ce qu’ils constituent le fondement de toute vie sociale » (Goodman) ;
e) « Tandis que le gradualisme marxiste et socialiste tente d’agir par le biais de l’État en étendant les activités de l’État jusqu’à ce que celui-ci absorbe toute la vie sociale, pour le gradualisme libertaire, il s’agit, ici et maintenant, d’entrer dans des relations non étatiques, des relations fondées sur l’entraide coopérative et le soutien mutuel » (Ostergaard) ;
f) Différence fondamentale entre public, étatique et privé ;
g) Ce qui devrait préoccuper et engager les anarchistes, ce sont les « changements sociaux par lesquels les gens peuvent accroître leur autonomie et réduire leur assujettissement à une autorité extérieure » (Ward) ;
h) Agir avec un esprit révolutionnaire dans une situation donnée (Lire) ;
i) Le scepticisme à l’égard de l’idée même de société anarchiste. Molnar l’appelle le « théorème d’impossibilité ». Il est impossible (ou improbable) que l’anarchie puisse obtenir un consentement universel à moins que la force ne soit utilisée pour l’imposer. Mais, comme l’a dit Malatesta, l’anarchie ne se crée pas par la force. Ward écrit : « Toute société humaine, à l’exception des utopies ou dystopies les plus totalitaires, est une société pluraliste avec de larges zones qui ne se conforment pas aux valeurs officiellement imposées ou déclarées » ;
j) Une réponse de protestation purement individuelle et permanente ne suffit pas ; il est nécessaire de modifier les structures sociales et les relations communautaires. En effet, comme le souligne Ward : « si l’idée d’une société libre peut être une abstraction, celle d’une société plus libre ne l’est pas. » L’idée d’une société anarchiste ne doit pas être comprise tant « comme un but à atteindre que comme une échelle graduée, une unité de mesure, un moyen d’évaluer la réalité. » Ainsi, l’anarchie est perçue comme un critère normatif ; autrement dit, le critère éthique fondamental pour juger les mérites des différentes sociétés réside dans leur degré d’anarchie.
k) Distinction entre principe social et principe politique. Martin Buber écrit : « L’État tend à s’approprier plus de pouvoir que nécessaire dans une situation donnée […] La mesure de cet excès représente la différence exacte entre administration et gouvernement […] Surplus politique […], le principe politique est toujours plus fort que le principe social requis par une situation donnée. Il en résulte une diminution continue de la spontanéité sociale. »
l) L’anarchie, comprise comme une forme de relations sociales, est déjà présente dans la société : « Loin d’être la représentation théorique d’une société future, l’anarchie décrit une forme d’organisation humaine, enracinée dans l’expérience du quotidien, qui coexiste avec les tendances autoritaires dominantes ; malgré elles, des alternatives anarchistes existent déjà au sein même de la structure du pouvoir dominant. Si nous voulons construire une société libre, certains éléments sont déjà disponibles. » Les caractéristiques fondamentales communes à de nombreuses expériences concrètes allant dans ce sens sont : une forte référence à l’action individuelle directe (des acteurs et non de simples consommateurs d’un bien produit pour eux), une référence significative aux relations mutualistes et d’entraide : l’anarchie ainsi comprise est une forme d’« autodétermination sociale » qui s’oppose souvent à la fois à la bureaucratie d’État et aux injustices du libéralisme économique.
m) L’anarchie est utile pour résoudre les problèmes : rechercher des solutions anarchistes au lieu de s’attarder sur la rhétorique de la révolution ;
n) L’échec des anarchistes, selon Woodcock, est dû au « manque de propension à faire des propositions concrètes qui pourraient conduire à leur vision vague et floue d’une société idyllique », les masses préférant suivre ceux qui pouvaient offrir des solutions concrètes à des problèmes concrets ;
o) Gaston Leval critique l’idée que l’anarchisme devrait se définir uniquement par ce à quoi il s’oppose : « un mouvement social ne peut pas vivre de la négation ». L’anarchisme doit proposer un programme constructif et, pour ce faire, « nous devons acquérir les compétences et l’expérience nécessaires pour convaincre ceux que nous entendons influencer qu’ils sont des hommes capables, sérieux et responsables, et non de simples agitateurs ou des révolutionnaires amateurs ».
p) L’anarchie est un type de relation sociale caractérisé par l’action coopérative égalitaire d’individus qui se définissent comme tels. Si le champ de cette mutualité autogérée s’étendait à l’ensemble de la vie sociale, nous serions sans aucun doute confrontés à une société sans État. Mais même en dehors d’une telle société, nous pouvons disposer d’un degré plus ou moins important de réciprocité, et donc d’anarchie.
Je crois qu’il nous faut intégrer l’anarchie au présent plutôt que de la reporter à une hypothétique société future sans État. Les mouvements de protestation internationaux des vingt dernières années, les contributions de penseurs tels que David Graeber, James Scott, John Clark, Amedeo Bertolo, Nico Berti, Eduardo Colombo, Matthew Wilson et Tomás Ibáñez – malgré leurs différences de sensibilité et d’approche – et d’autres encore, nous incitent à approfondir cette perspective novatrice, tout en soulignant les contradictions et les difficultés auxquelles une idée libertaire ouverte est inévitablement confrontée.
Selon cette conception, le rôle concret de l’anarchiste n’est pas la réalisation de ce rêve inaccessible, mais plutôt l’orientation de la complexité désordonnée de la société vers une plus grande anarchie. Le meilleur moyen de promouvoir cette cause est de vérifier concrètement comment l’anarchie, comprise comme une mutualité autogérée, peut contribuer à la résolution de besoins sociaux spécifiques. Autrement dit, il s’agit de maximiser le degré d’anarchisme dans le monde où nous vivons. « La tâche de l’anarchiste n’est cependant pas de rêver d’une société future, mais plutôt d’agir de la manière la plus anarchique possible au sein de la société actuelle, d’éviter autant que possible les situations où il est contraint de commander, et de s’efforcer de promouvoir des relations de coopération mutuelle et volontaire entre ses semblables. Dans le monde moderne, l’État est la manifestation la plus importante du principe de coercition. Par conséquent, pour parvenir à l’anarchie, il est nécessaire de renoncer à l’État ; et cela se fera dans la mesure où les individus sont capables de vivre sans lui » (Ostergaard).
Enfin, je tiens à souligner une autre étape indispensable qu’il convient d’aborder de manière proactive. Je fais référence aux caractéristiques qui définissent une société idéale selon une vision libertaire. Trop souvent, les mouvements anarchistes ont également imaginé un modèle de société alternative, en esquissant des particularités dans les sphères économique, sociale et politique. Dans ce cas, les idées anarchistes se sont alignées sur une tradition utopique et, d’un point de vue structurel, se sont conformées à celles d’autres idéologies alternatives au libéralisme. Il semble donc urgent de libérer notre imagination d’une conception aussi rigide et fermée d’un « autre » monde, au profit d’une vision pluraliste et diversifiée, expérimentale et ouverte même dans notre réflexion sur les contours d’un monde différent possible. Pour paraphraser Colin Ward :
« L’alternative anarchiste est celle qui propose la fragmentation et la division plutôt que la fusion, la diversité plutôt que l’unité ; en bref, elle propose une masse de sociétés et non une société de masse. »
Ce ne sont là que quelques considérations, exprimées schématiquement, qui, nous l’espérons, pourront stimuler la réflexion et, surtout, une action plus adaptée aux défis du XXIe siècle et qui ne sont en aucun cas irréversibles ou dogmatiques.
Francesco Codello –
